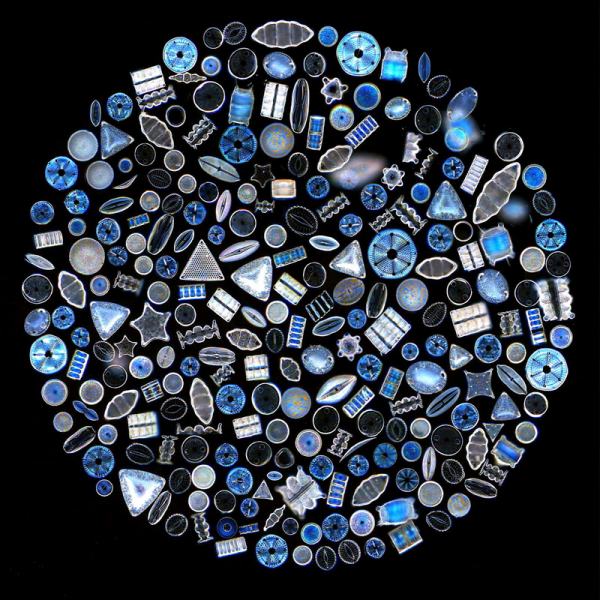Un script d’audition sans faille
Cette méthode d’interrogatoire est une route balisée vers l’aveu.
Mis au point par les policiers John REID et Fred INBAU, dans les années 60 à Chicago, ce modèle se décline en 9 étapes :
1- Confrontation
On fait comprendre au suspect que l’on détient des preuves de sa culpabilité, et que l’entrevue ne vise pas à prouver son innocence mais à comprendre ses motivations.
2- Développement du thème
Le but est d’obtenir l’acquiescement du suspect : on offre au suspect des excuses afin de minimiser sa culpabilité, on fait porter la responsabilité à quelqu’un d’autre que lui, et on développe des thèmes différents autour des circonstances qui entourent le crime.
3- Traitement des démentis
Il s’agit de décourager le suspect de nier sa culpabilité, ce qui ralentit la confession.
4- Surmonter les objections
Le suspect argumente et passe à l’offensive en répondant au thème choisi par l’interrogateur, afin d’écarter celui-ci de la direction prise par les questions. Les objections du suspect se transforment alors en stratégie défensive. Les tentatives de simples de dénis deviennent des objections structurées. L’interrogateur va alors transformer ces objections en admission de culpabilité, en les encourageant tout en développant le thème abordé.
 5- Capter l’attention du suspect
5- Capter l’attention du suspect
Découragé par le peu d’effets qu’ont ses objections sur l’interrogateur, le suspect va sans doute chercher une aide extérieure pour échapper à cet interrogatoire, ou se réfugiera dans le mutisme. L’interrogateur doit alors rétablir un lien de complicité, se présentant comme un allié, et empêchera le suspect de se détacher de l’audition en maintenant son attention, et le rendre plus réceptif.
6- Traiter la résolution
Le suspect est résigné, et devient passif : il est vulnérable. L’interrogateur le mène alors vers le chemin de la confession. Les thèmes abordés se transforment en motifs. Le suspect doit alors choisir les raisons de son acte. S’il pleure, c’est un aveu de culpabilité.
7- Alternatives
L’interrogateur offre au suspect deux motifs opposés au crime commis, et l’encourage à choisir : l’un acceptable socialement, l’autre moralement abject. Crime passionnel versus crime crapuleux, par exemple.
8- Amener le suspect à converser
Dès que le suspect a choisi une alternative, prémisse d’aveu de culpabilité, le processus de la confession s’accélère. L’interrogateur encourage le suspect à parler du crime en introduisant un deuxième interrogateur afin d’accentuer le stress de ce dernier. Le processus de confession a commencé.
9- Les aveux
Etape finale visant à obtenir une déposition signée, ayant une force probatoire incontournable.
Ce script bien huilé menant à une confession, n’est pas le plus appliqué en France, car non compatible avec la législation française qui repose sur la présomption d’innocence, mais reste la base standard de l’interrogatoire des forces de police dans la majorité des pays.
Innocence et aveux de culpabilité : Paradoxal ?
De telles techniques d’interrogatoire sont psychologiquement coercitives. Cependant, avouer un crime que l’on n’a pas commis nous semble inenvisageable, et pourtant …
Selon les statistiques d’Innocence Project, 20 à 25% des personnes disculpées par des analyses ADN avaient été condamnées à la suite de faux aveux.
 Saul KASSIN, psychologue et enseignant au John Jay College of Criminal Justice de New-York, distingue trois types de faux aveux :
Saul KASSIN, psychologue et enseignant au John Jay College of Criminal Justice de New-York, distingue trois types de faux aveux :
- Spontanés
soit pour se faire valoir, se mettre en avant pour sortir de l’anonymat et avoir l’impression d’être « spécial », considéré
soit pour protéger une tierce personne.
- Extorqués
en offrant au suspect un « marché » de dupe, faisant miroiter un allègement de peine en cas d’aveux
- Par injection de faux souvenirs
A force de s’entendre répéter une autre version que celle dont on se souvient, on finit par y croire. La technique consiste à injecter un souvenir fabriqué noyé au milieu de souvenirs bien réels, que l’on intègre comme siens.
Selon une étude parue en 2015, menée par deux chercheurs canadiens, 70% des participants ont été sujets à de faux souvenirs injectés.
L’interrogatoire suggestif, assorti d’une stratégie de minimisation, achève de convaincre certains suspects de crimes qu’ils n’ont pas commis.
Dans de nombreux cas de faux aveux, le suspect accorde un poids plus important aux conséquences immédiates qu’aux conséquences lointaines, qu’il juge comme hypothétiques.
Ainsi Patrick DILS a avoué car il voulait juste rentrer chez lui.
Lorsque Saul KASSIN a demandé à de nombreux suspects s’étant confessés à tort la raison pour laquelle ils n’avaient pas demandé la présence d’un avocat, tous lui répondirent :
Je ne pensais pas en avoir besoin, j’étais innocent !